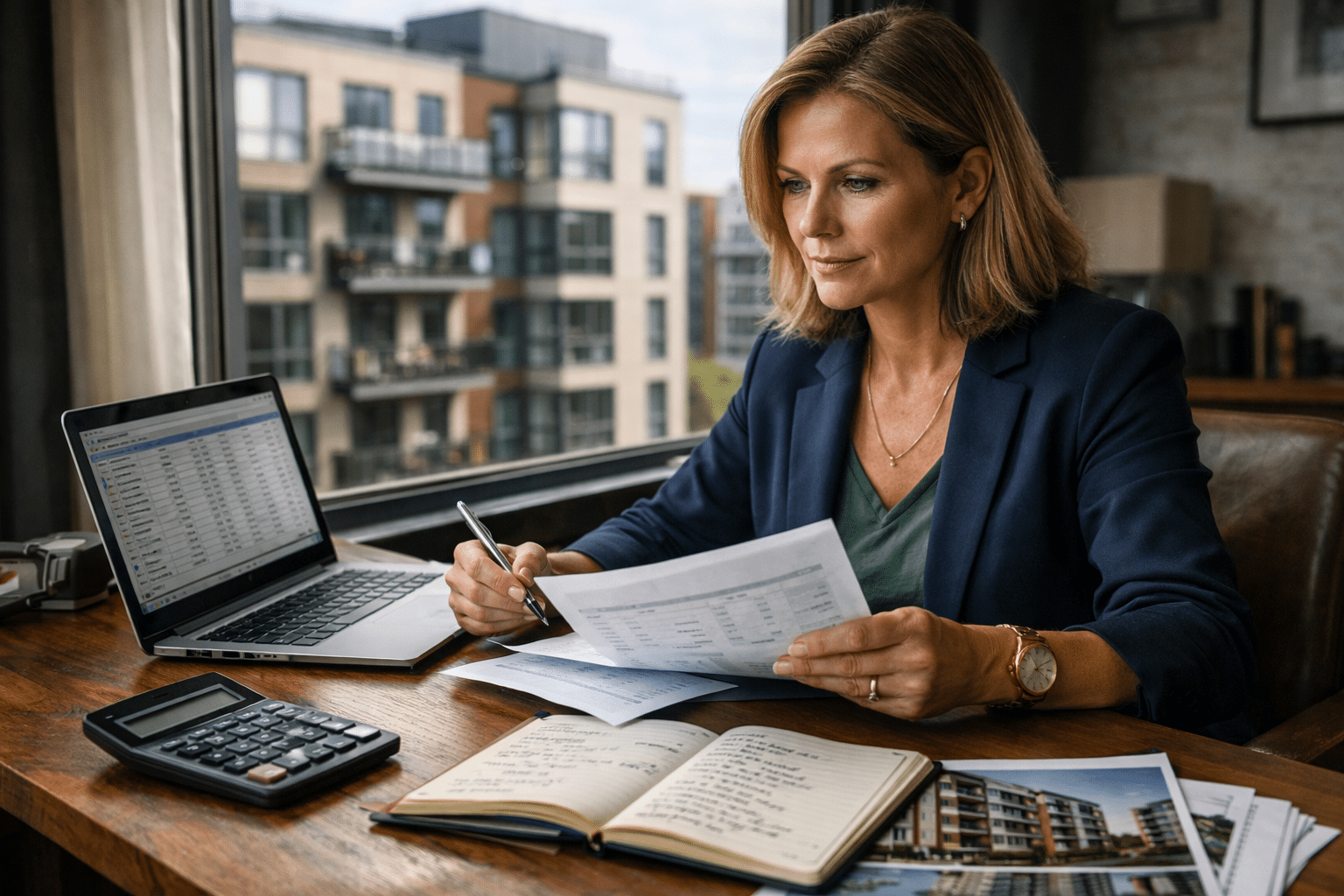Avant la politique, Donald Trump a appris le métier au contact de son père et a très vite voulu jouer dans une autre catégorie. Ce premier chapitre retrace les bases de son parcours : l’école de terrain à Brooklyn, les arbitrages financiers, puis l’envie d’attaquer Manhattan avec des projets plus ambitieux.
Les débuts de Donald Trump avec son père Fred
Brooklyn et les premiers projets familiaux
Formé par Fred Trump, promoteur orienté vers le logement abordable, Donald découvre très tôt le cœur du métier : acquisition de terrains, montage financier, gestion d’équipes et suivi de chantier. Ce terrain d’apprentissage, loin des paillettes, lui donne des réflexes d’optimisation et une approche strictement orientée rentabilité.
Dans l’entreprise familiale, il s’attaque à des opérations modestes mais nombreuses. Il observe comment réduire le risque par la standardisation des bâtiments et des matériaux, comment négocier avec les banques locales, et surtout comment tenir les délais pour sécuriser la marge.
Ces premières années lui apprennent aussi le pilotage administratif : permis de construire, normes, fiscalité. Donald comprend qu’un projet se gagne autant au bureau qu’au chantier et que la maîtrise du cadre réglementaire accélère la commercialisation.
L’ambition de dépasser l’héritage paternel
Très vite, Donald considère Brooklyn comme une rampe de lancement. Il estime que la valeur se crée davantage au cœur de Manhattan, là où la demande internationale et les loyers de prestige tirent les prix. Son objectif : passer d’un modèle “volume et contrôle des coûts” à un modèle “signature et visibilité”.
Pour y parvenir, il mise sur des emplacements iconiques, des partenariats bancaires plus puissants et une communication calibrée. L’idée est simple : concevoir des projets capables de générer une prime de rareté grâce à l’architecture, au positionnement luxe et à l’expérience client, afin d’obtenir des prix au mètre carré supérieurs.
Ce changement d’échelle s’accompagne d’un style managérial plus directif et d’un goût pour la négociation “à l’américaine”. Donald multiplie les rendez-vous avec décideurs, architectes vedettes et investisseurs, convaincu que la valeur d’un projet tient autant à son financement qu’à sa façade.
Cette ambition, parfois jugée agressive, devient sa marque de fabrique : raconter une vision claire, sécuriser le montage, puis exécuter vite. Le socle appris auprès de Fred — prudence financière, contrôle des coûts, sens du calendrier — reste présent, mais s’efface derrière une promesse : créer des actifs repères qui “font l’adresse” et renforcent la notoriété du promoteur.
Les premiers grands projets immobiliers à Manhattan
La rénovation du Commodore Hotel
Le premier coup d’éclat de Donald Trump se joue au cœur de Manhattan. En 1976, il repère le Commodore Hotel, un établissement vieillissant situé à proximité de Grand Central. L’immeuble, promis à l’abandon, attire peu d’investisseurs. Donald saisit l’occasion et négocie un montage complexe avec la ville de New York et la chaîne Hyatt.
Grâce à un accord fiscal avantageux, il transforme le bâtiment en un hôtel moderne de plus de 1 500 chambres. Le nouveau Hyatt Regency devient rapidement un succès commercial et médiatique. Ce projet révèle la capacité de Trump à allier finance, politique et communication pour sécuriser des opérations de grande envergure.
Cette réussite lui donne une crédibilité immédiate dans le cercle fermé des grands promoteurs new-yorkais et confirme son ambition : Manhattan sera désormais son terrain de jeu.
La Trump Tower, symbole de luxe et de démesure
En 1979, Donald franchit un nouveau cap en acquérant l’immeuble situé face à Tiffany & Co, sur la 5e Avenue. À cet emplacement stratégique, il fait ériger la célèbre Trump Tower, un gratte-ciel de 68 étages combinant résidences de luxe, bureaux et commerces haut de gamme.
Marbre italien, verrières spectaculaires, ascenseurs dorés : le projet devient un manifeste de son style “Trumpish”, où le luxe ostentatoire se mêle à l’efficacité commerciale. Les boutiques Gucci, Cartier ou Loewe paient des loyers exorbitants, tandis que les appartements se vendent en moyenne à 1 million de dollars, un record pour l’époque.
La Trump Tower attire rapidement célébrités et investisseurs. Steven Spielberg, Sophia Loren ou encore Lady Diana figurent parmi les personnalités séduites par l’adresse. Le bâtiment devient non seulement une réussite financière, mais aussi un symbole mondial du positionnement de Trump : spectaculaire, visible et rentable.
En installant son bureau et son triplex au sommet, Donald envoie un signal clair : il n’est pas seulement un promoteur, mais une marque à part entière. Son nom inscrit en lettres d’or incarne la réussite qu’il veut vendre à ses clients.
Avec ces deux projets, le Hyatt et la Trump Tower, Donald Trump se positionne comme le nouveau visage de l’immobilier de prestige new-yorkais, capable de transformer des bâtiments en difficultés en icônes urbaines et de capter l’attention médiatique autant que la valeur immobilière.
L’expansion vers Atlantic City et les casinos
Le Trump Plaza et le Trump Castle
Après Manhattan, Donald Trump décide de s’attaquer à un autre secteur lucratif : le jeu. À Atlantic City, haut lieu des casinos sur la côte Est, il rachète plusieurs établissements emblématiques pour y apposer sa marque. Le Trump Plaza, premier casino-hôtel qu’il inaugure, affiche un décor somptueux, avec marbre noir, dorures et suites personnalisées pour attirer la clientèle aisée.
Peu après, il lance le Trump Castle, imaginé comme une forteresse luxueuse, avec des tourelles dorées et une décoration extravagante. Là encore, l’objectif est clair : combiner rentabilité et visibilité, en offrant un cadre inédit dans un marché déjà saturé par la concurrence.
Ces établissements traduisent l’approche habituelle de Trump : miser sur le spectaculaire et multiplier les détails clinquants, qu’il s’agisse de bidets importés d’Europe ou de robinets plaqués or, rarissimes aux États-Unis à l’époque.
Entre faste et désillusions
Malgré des investissements colossaux, Atlantic City ne répond pas totalement aux attentes de Trump. Son ambition était d’attirer les “beautiful people”, amateurs de luxe et de mondanités. Mais la clientèle locale, davantage passionnée par le jeu que par les strass, ne correspond pas à l’image qu’il souhaite donner de ses établissements.
Les casinos peinent à générer la rentabilité espérée. Le faste, les salles de bal dessinées par son épouse, la communication autour du glamour : rien ne suffit à transformer Atlantic City en vitrine mondaine comparable à Las Vegas. Trump doit composer avec une réalité plus brutale que prévue.
Ces déceptions révèlent une limite de sa stratégie : l’excès de confiance dans la communication ne compense pas toujours la logique économique du marché. Le casino reste un univers de joueurs passionnés, peu sensibles aux artifices architecturaux, et la concurrence y est féroce.
Pour autant, Donald Trump capitalise sur ces projets en renforçant son image publique. Même si les chiffres ne sont pas toujours au rendez-vous, les inaugurations spectaculaires, les publicités luxueuses et les personnalités invitées entretiennent sa réputation de bâtisseur ambitieux et de promoteur prêt à tout pour marquer son époque.
Atlantic City représente donc une étape charnière : une vitrine de grandeur et de démesure, mais aussi une leçon de prudence face à des marchés qui ne se plient pas toujours à la volonté d’un promoteur, fût-il milliardaire.
Television City et la vision grandiose de Trump
Un projet pharaonique pour l’Hudson River
À la fin des années 1980, Donald Trump imagine l’un de ses projets les plus ambitieux : Television City. Sur plus de 170 hectares de terrains ferroviaires en friche, il souhaite ériger une véritable cité dédiée aux médias et au divertissement, avec studios de production, espaces commerciaux, zones résidentielles et parcs. Le tout dominé par une tour gigantesque de 150 étages, destinée à devenir la plus haute du monde.
L’objectif de Trump est clair : transformer la rive ouest de Manhattan en un pôle d’innovation et de prestige, à l’image de la Silicon Valley pour la technologie. Il promet la création de 40 000 emplois et la venue de milliers de résidents, convaincu que le projet va redessiner la carte de New York.
Cette vision illustre parfaitement son style : penser en grand, jouer sur l’effet de rupture et séduire les décideurs comme les investisseurs en leur vendant une ambition hors norme.
Les critiques et la contestation des riverains
Derrière l’enthousiasme affiché, Television City déclenche rapidement une vague de protestations. Les habitants du quartier, les élus locaux et les associations d’urbanisme dénoncent la démesure du projet et son impact environnemental et visuel. Les six tours secondaires initialement prévues, dessinées par l’architecte Helmut Jahn, suscitent une opposition unanime.
Donald Trump doit revoir sa copie. Il abandonne une partie des tours mais maintient sa volonté de bâtir la grande tour centrale, censée dépasser la Sears Tower de Chicago. Pour redonner du crédit au projet, il confie la nouvelle conception au cabinet Alexander Cooper and Partners, connu pour ses rénovations urbaines plus intégrées.
Malgré cette adaptation, le projet reste perçu comme un symbole d’urbanisme agressif, privilégiant le prestige personnel à l’équilibre collectif. La presse souligne les incohérences entre la promesse de création d’emplois et la faisabilité réelle d’un tel chantier.
Television City marque ainsi un tournant : il illustre à la fois la capacité de Trump à proposer des visions spectaculaires et son incapacité à faire consensus face aux contraintes sociales et politiques. C’est le paradoxe de son parcours : séduire par la grandeur mais diviser par la démesure.
Si le projet n’aboutit pas tel qu’il était imaginé, il nourrit toutefois la légende du promoteur prêt à repousser les limites et à inscrire son nom dans l’histoire urbaine de New York, quitte à affronter la critique de front.
Style et controverses autour de l’empire Trump
Le goût du marbre, du doré et du spectaculaire
Chaque projet de Donald Trump porte une signature reconnaissable : l’ostentation et la démesure. Marbres italiens aux teintes chaudes, vitres miroirs, atriums immenses et omniprésence des dorures composent son vocabulaire architectural. L’objectif est simple : créer des lieux où le luxe se voit immédiatement et où chaque visiteur a le sentiment d’entrer dans un univers exclusif.
Ces choix esthétiques ne répondent pas seulement à une logique décorative. Ils sont conçus pour générer une prime d’image : boutiques prêtes à payer des loyers record pour une adresse iconique, célébrités séduites par l’idée d’habiter un gratte-ciel unique, médias attirés par l’exubérance des lieux. La stratégie repose sur la conviction que plus un projet brille, plus il attire l’attention — et donc la valeur.
Ce style “Trumpish” finit par devenir un argument de vente en soi. Acheter ou louer dans un immeuble Trump, c’est accéder à une certaine idée de la réussite et du prestige, au-delà du simple usage résidentiel ou commercial.
Les critiques sur ses excès et ses exagérations
Ce goût du spectaculaire s’accompagne de polémiques récurrentes. Plusieurs voix dénoncent un promoteur plus intéressé par l’apparence que par la qualité durable des bâtiments. Certains reprochent la destruction d’éléments patrimoniaux, comme les bas-reliefs Art déco sacrifiés pour laisser place à la Trump Tower, perçue comme un geste purement financier.
Donald Trump est également critiqué pour ses exagérations personnelles. Il s’est par exemple vanté d’être sorti premier de Wharton, affirmation jamais confirmée par les archives de l’école. Dans la presse, il est qualifié de “Michael Jackson de l’immobilier”, attiré par tout ce qui brille, quitte à déformer la réalité.
Ces controverses nourrissent un portrait ambivalent : d’un côté, un bâtisseur capable de redonner vie à des quartiers et de réaliser des chantiers que la ville peinait à mener à bien ; de l’autre, un promoteur jugé manipulateur, cherchant avant tout la lumière médiatique et la valorisation de son nom.
Trump répond aux critiques par des démonstrations concrètes, comme la rénovation éclair de la patinoire de Central Park, laissée en friche par la municipalité pendant des années. En quatre mois seulement, il la remet en état et s’attribue le mérite de ce sauvetage, renforçant ainsi son image d’homme d’action efficace.
Ce mélange de faste, de communication et de controverse contribue à forger la légende Trump : un promoteur que l’on admire ou que l’on critique, mais que l’on ne peut ignorer.