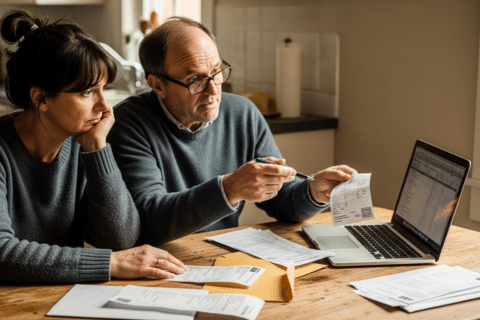Adoptée à l’Assemblée nationale fin octobre, la création de l’impôt sur la fortune improductive suscite de vifs débats. Cette réforme fiscale majeure de 2025 entend remplacer l’IFI et élargir la taxation à de nouveaux actifs jugés « improductifs », des bijoux aux cryptomonnaies. Mais qui sera réellement concerné par cette mesure ?
Comprendre le nouvel impôt sur la fortune improductive
De l’IFI à un impôt plus large
Adopté à la majorité par une coalition inédite, ce nouvel impôt met fin à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Désormais, il englobe non seulement les biens immobiliers mais aussi d’autres formes de patrimoine comme les œuvres d’art, les yachts, les bijoux, les assurances-vie et les cryptomonnaies. Tous ces actifs sont jugés « improductifs », car ils ne participent pas directement au financement de l’économie réelle.
Cette réforme résulte d’une alliance entre le MoDem et le Parti socialiste, qui ont voulu corriger les limites de l’IFI. L’objectif affiché est de rendre la fiscalité du patrimoine plus équitable, tout en décourageant la détention d’actifs spéculatifs.
Une taxe censée encourager l’investissement productif
En taxant davantage les biens considérés comme improductifs, le gouvernement souhaite pousser les contribuables fortunés à réinvestir dans l’économie réelle. Sont valorisés, par exemple, l’immobilier locatif, les participations dans les entreprises ou encore les placements dans l’innovation.
Selon le député Philippe Brun, cette mesure n’a pas vocation à punir, mais à orienter le capital vers des secteurs créateurs de valeur et d’emplois. Un pari économique autant qu’idéologique, qui divise déjà les milieux d’affaires.
Barème, abattements et seuils applicables
Un taux unique à 1 % : simplification ou injustice ?
Le nouveau dispositif remplace le barème progressif de l’IFI par un taux unique de 1 %, applicable dès 1,3 million d’euros de patrimoine net. Ce choix vise à simplifier la déclaration fiscale, mais il modifie la répartition de l’effort. Les patrimoines intermédiaires, plus proches du seuil d’entrée, pourraient voir leur charge augmenter, tandis que les très grandes fortunes bénéficieraient mécaniquement d’un allègement.
Certains économistes saluent cette simplification, y voyant une façon de rendre le système plus lisible. D’autres y voient une injustice fiscale, car elle uniformise des situations patrimoniales très différentes.
La résidence principale, un cas à part
Pour atténuer les effets de la réforme, la loi prévoit un abattement d’un million d’euros sur la valeur d’une résidence principale par foyer fiscal, en plus de la réduction habituelle de 30 %. En pratique, un logement estimé à 1,4 million d’euros serait largement exonéré. Cette mesure vise à protéger les ménages dont la fortune repose essentiellement sur leur bien immobilier.
Les experts fiscaux y voient une continuité avec le dispositif antérieur, tout en notant que le seuil d’entrée fixé à 1,3 million d’euros reste sensible pour les zones à forte pression immobilière comme Paris ou Lyon.
Qui gagne, qui perd ? Les enjeux économiques et politiques
Impact estimé sur les recettes publiques
Selon les estimations du Parti socialiste, cette réforme pourrait rapporter jusqu’à 4 milliards d’euros par an, contre 2,2 milliards pour l’IFI en 2024. Ce chiffre reste toutefois jugé optimiste par de nombreux économistes, qui soulignent la complexité de l’évaluation des actifs non productifs comme les œuvres d’art ou les cryptomonnaies.
Pour le gouvernement, cet impôt doit avant tout favoriser la réallocation des capitaux vers les secteurs productifs, et non devenir une source majeure de revenus fiscaux. Mais le débat reste ouvert sur son véritable rendement à long terme.
Un retour déguisé de l’ISF ?
Pour une partie de la gauche, cette mesure marque le retour symbolique de l’ISF, supprimé en 2017. Le député Philippe Brun s’en félicite, parlant d’une « justice fiscale restaurée ». À l’inverse, la majorité présidentielle et les libéraux dénoncent un signal négatif pour l’attractivité du pays.
Au-delà de la technique fiscale, c’est une bataille idéologique qui se joue à l’Assemblée : faut-il taxer la richesse pour encourager la productivité, ou au contraire, alléger la pression pour stimuler l’investissement ? Le vote serré de 163 voix contre 150 illustre bien la division profonde autour de cette question.