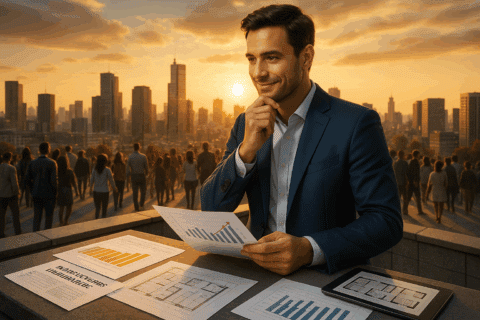Derrière les images persistantes de propriétés de luxe et d’opulence, la réalité des multipropriétaires français se révèle bien plus nuancée. À rebours des clichés, la multipropriété concerne une grande diversité de profils, loin du cercle restreint qu’on imagine souvent. Plongeons ensemble dans les dynamiques qui façonnent ce segment du marché immobilier hexagonal, grâce à des données inédites et des analyses approfondies.
Qui compose aujourd’hui le paysage des multipropriétaires ?
La définition du multipropriétaire reste simple : il s’agit de toute personne possédant au moins deux logements sur le territoire français.
Selon les dernières statistiques, cette catégorie représente près d’un tiers des propriétaires, soit environ 9,7 millions de particuliers.
Ce chiffre dépasse largement l’idée que s’en font généralement les observateurs du marché.
Cependant, tous n’ont pas un vaste parc immobilier. En réalité, la majorité ne possède que deux logements.
Certains combinent une résidence principale avec une résidence secondaire ; d’autres préfèrent investir dans un appartement ou une maison destinée à la location.
Les détenteurs de grands portefeuilles restent rares : seules 3 % des personnes concernées détiennent dix biens ou plus.
Quelle est la véritable répartition selon l’âge et le genre ?
L’accumulation de biens immobiliers apparaît surtout après 25 ans, signe que l’accès à la multipropriété intervient rarement en début de vie active.
La proportion grimpe nettement entre 55 et 65 ans, atteignant alors un pic : près de trois adultes sur dix de cette tranche d’âge disposent de plusieurs logements.
Cette tendance traduit la montée en puissance patrimoniale liée à l’ancienneté professionnelle et l’effet boule de neige d’investissements réalisés tôt.
Avec le temps, l’accès à la multipropriété devient plus aisé, notamment grâce à un endettement maîtrisé ou aux héritages.
Après 65 ans, la part de multipropriétaires diminue progressivement, souvent sous l’effet de rachats familiaux ou de ventes pour financer d’autres projets.
Des disparités notables liées au genre
La parité est encore loin d’être atteinte parmi les détenteurs de nombreux biens immobiliers.
Plus le portefeuille grandit, plus la part féminine recule : si les femmes représentent presque la moitié des multipropriétaires de deux biens, leur présence chute nettement au-delà de dix logements.
Plusieurs facteurs expliquent cet écart, notamment l’impact persistant des écarts salariaux ou la répartition inégale des droits de succession.
Toutefois, lorsque la possession se limite à deux résidences, la mixité s’équilibre davantage et rejoint la moyenne nationale.
Quels revenus pour les multipropriétaires ?
Les chiffres montrent que les multipropriétaires affichent des revenus supérieurs de 25 % en moyenne par rapport aux mono-propriétaires, tous types de ressources confondus (notamment les loyers).
Disposer d’un patrimoine immobilier permet de sécuriser, voire d’augmenter ses ressources, creusant ainsi l’écart avec les non-propriétaires.
Sans surprise, les revenus élevés sont surreprésentés chez les multipropriétaires. Parmi les 10 % les plus aisés, six personnes sur dix possèdent au moins deux biens.
Cette concentration d’actifs immobiliers influe fortement sur la capacité d’investissement et de transmission patrimoniale.
Répartition géographique et typologie des logements détenus
La dimension territoriale fait apparaître des contrastes flagrants.
Dans certaines métropoles ou zones touristiques, la majorité des logements privés appartient déjà à des multipropriétaires.
Sur la Côte d’Azur ou dans la région marseillaise, cette proportion peut dépasser les trois quarts du parc locatif privé, reflet d’un fort dynamisme résidentiel.
À Paris, près de 40 % des appartements ou maisons mis en location relèvent de cette catégorie d’investisseurs, avec une forte présence dans les arrondissements historiques centraux.
Le phénomène s’accentue là où les tensions immobilières sont maximales, c’est-à-dire dans les secteurs à forte demande locative tout au long de l’année.
Utilisation courante des propriétés
Contrairement aux idées reçues, seule une fraction des biens sert de résidence secondaire.
Pour près de la moitié, il s’agit du logement principal ; certains acquièrent successivement sans jamais revendre.
D’autres préfèrent mettre leurs biens en location afin de percevoir des loyers réguliers, une stratégie de protection et d’optimisation du patrimoine sur le long terme.
Enfin, une part notable correspond à des logements vacants. Environ 2,1 millions de ces biens n’ont pas été occupés depuis un an ou plus, particulièrement concentrés dans les métropoles et sites touristiques.
Cette situation interroge autant sur le rendement locatif que sur la disponibilité réelle du parc en période de forte pression sur le marché.
Facteurs clés de l’accès à la multipropriété
Pour constituer un patrimoine immobilier dépassant la résidence unique, plusieurs leviers existent.
Certains privilégient la location meublée progressive, d’autres misent sur l’achat-revente ou sur l’acquisition de logements anciens à rénover.
Voici quelques voies fréquemment empruntées par les multipropriétaires :
- Investissement locatif saisonnier dans les régions touristiques pour générer des rendements optimisés.
- Acquisition de biens dans les grandes villes étudiantes en vue d’une revente future valorisée.
- Transmission proactive via des montages familiaux visant à préserver et répartir le patrimoine.
- Diversification entre résidences principales, secondaires et lots destinés à la location longue durée.
La réussite dans la multipropriété repose en grande partie sur une bonne connaissance des dispositifs juridiques, fiscaux et financiers.
De nombreuses formations accompagnent celles et ceux qui souhaitent rejoindre ce cercle grandissant – preuve que ce modèle séduit autant qu’il interroge quant aux évolutions futures du secteur immobilier français.